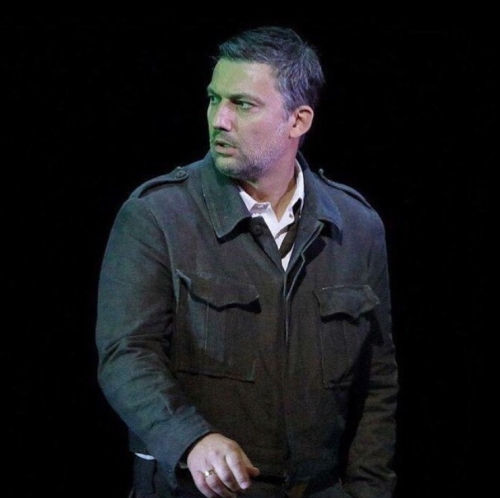« Simplement, rendre la prison visible » (Paul Claudel)

(photo: Bertrand Stofleth/Opéra de Lyon)
De l’œuvre de Janacek, les spectateurs ont encore en mémoire, la vision en clair-obscur de Patrice Chéreau d’une prison aux allures de bagne, où les prévenus traînaient après eux leurs vies et leurs souffrances comme les chaînes qu’ils portaient aux poignets. Une lecture qui a ensuite inspiré, en écho, la vision des autres metteurs en scène qui se sont ultérieurement confrontés à l’œuvre. A Lyon, et précédemment à Bruxelles et à Londres, Krzysztof Warlikowski nous propose une approche diamétralement opposée, contemporaine et ultra réaliste, qui ne s’arrête pas aux murs de la prison. La force de la proposition du metteur en scène est précisément d’avoir su s’affranchir de la vision de Chéreau pour donner un élan nouveau à l’oeuvre à travers des questionnements sur la justice. Car c’est bien cette institution qui est le point de convergence de toute la réflexion de Warlikowski comme l’illustrent les mots qu’il assène en préambule aux spectateurs : « Pour vous, quelle est la fonction des juges dans la société ? ».
D’emblée, le metteur en scène nous enchaîne à cette puissante interrogation. Il enfonce ensuite le clou en s’appuyant sur les mots de Michel Foucault dans un entretien sur la justice et la police dont un extrait est projeté sur un écran en introduction au spectacle. Les juges seraient des exécutants de règles normatives. Ils appliqueraient un barème en tenant seulement compte de la gravité de l’acte commis et attendraient des prévenus qu’ils acceptent leurs punitions. Ce seraient donc les sentences qui font et défont les vies derrière les murs des prisons, qui accordent des droits, les retirent, et infligent des peines au double sens du mot. C’est oublier un peu vite l’individualisation des sanctions, les aménagements de celles-ci et la réinsertion par la réflexion du prévenu sur la portée et les conséquences de l’acte commis. Ces infinies nuances du droit et du suivi que le prononcé d’une peine implique sont aujourd’hui une réalité et sont consacrées par les textes de loi. C’est pourquoi au-delà des mots de Foucault, Warlikowski tente de nuancer le propos en posant un regard universaliste et humaniste sur la condition humaine plus que sur les conditions de détention, même si la prison telle qu’imaginée ici a plutôt des allures de quartier de haute sécurité tout droit sorti d’un blockbuster Hollywoodien, ou l’on joue aussi bien du basket que du couteau

(photo: Bertrand Stofleth/Opéra de Lyon)
L’univers carcéral qu’il nous est donné de voir ici, est contemporain, glauque, violent où l’on pense à la mort en permanence. La mort comme seul horizon. C’est ce qu’exprime dans une vidéo, un jeune garçon des quartiers difficiles, qui vit au milieu des gangs qui tiennent la rue. Qu’on soit dehors en plein cœur des guérillas urbaines, ou dedans derrière les murs en béton d’une forteresse bien gardée, la mort est omniprésente. Elle est une guetteuse silencieuse. Il est pour le moins frappant d’entendre ce jeune dire qu’il ne sera heureux que si, en mourant, il laisse quelque chose de glorieux de lui tel que sauver un enfant pris au piège entre les tirs croisés des gangs. Il n’envisage pas son avenir autrement qu’en acteur du chaos de la délinquance organisée. L’horizon est un champs de balles, la rue ou la prison est la tombe. Mais ne nous y trompons pas, De la Maison des morts est une œuvre humaniste d’où la lumière est loin d’être absente, et de cette déflagration de violence, de mots forts, d’interrogations puissantes naît paradoxalement dans la vision de Warlikowski une forme de grâce virtuose, dans ce spectacle que nous offre ces détenus sans cesse en mouvement. A l’instar de ce basketteur, dont les circonvolutions autour du panier sont accompagnées par la rythmique de danseurs de hip hop aux figures spectaculaires. A l’intérieur du cercle de la mort bat la vie. C’est cet élan bouillonnant qui nourrit aussi les querelles, les disputes, les violences, des détenus mais qui est aussi la force centrifuge de leurs rêves, leurs souvenirs, tout ce qui leur donne une raison encore d’espérer.

(photo: Bertrand Stofleth/Opéra de Lyon)
Dans ce monde décrit ici, il n’y a pas de héros. Aucun des protagonistes ne prend l’ascendant dans l’histoire. En prison, tous les hommes sont sur un pied d’égalité et ils s’expriment tous tour à tour sur leur vécu, ce qui les a conduits dans la pénombre en commettant l’irréparable et ce qu’ils espèrent encore de la vie. Dans une série de récits, tous plus saisissants les uns que les autres, les personnages se racontent dans une espèce d’auto analyse sous le regard des autres détenus. Le travail de Warlikowski met en lumière une émulation de groupe, les détenus puisant leur force dans l’énergie collective pour mieux se raconter. Goriantchikov, le seul qui semble innocent, interprété par le grand Willard White, prend corps dans une voix encore superbe pour atteindre de ténébreux abîmes comme faire jaillir la lumière notamment dans les échanges avec son ami Alieïa. Le ténor Pascal Charbonneau confère à ce dernier un timbre sombre dans le médium et un phrasé très rapide qui font merveille dans ce style de conversation parlée aux accents dissonants et saccadés qui caractérise l’œuvre. Sa puissance lui permet, en outre, de se faire entendre aisément dans les déchaînements orchestraux. Stefan Margita, qui a interprété à plusieurs reprises Louka, maîtrise son jeu à la perfection, tant vocalement que dramatiquement. Il a l’art de dire l’histoire de son personnage avec la même intensité dramatique qu’il le chante. Nicky Spense donne une belle présence à son Nikita, avec une voix ample et souple. Une mention spéciale doit être également attribuée au commandant d’Alexandre Vassiliev qui dispose d’une voix solide, bien posée, même si elle manque parfois de puissance et à la prostituée de Natascha Petrinsky, seule présence féminine dans cet univers mâle, qui se distingue par une voix claire et bien projetée. Le Chœur de l’Opéra livre ici une belle prestation, profonde et mélancolique, qui donne corps tant à la souffrance des détenus qu’à leur violence.

(photo: Bertrand Stofleth/Opéra de Lyon)
Si De la Maison des Morts ne se distingue pas par un esthétisme vocal et un art du beau chant, sa partition n’en a pas moins une belle texture musicale d’une grande subtilité, parfois inattendue, comme dans cette superbe ouverture qui offre un saisissant contraste avec l’univers sombre qu’il nous est donné de voir. On peut alors regretter qu’Alejo Perez, à la tête de l’Orchestre National de Lyon, livre une lecture un peu trop fougueuse de l’œuvre pour percevoir pleinement toutes les nuances de la partition. On entend, en effet, ici davantage la violence des détenus dans la battue sur-vitaminée du chef et les percussions soulignant les dissonances de la partition, que le rêve de liberté de chacun porté par les accents soyeux des cordes.
Au-delà d’une vision réductrice de la justice contenue dans des raccourcis hélas communément répandus, le metteur en scène réussi le tour de force de s’affranchir de la vision de Patrice Chéreau pour pénétrer et explorer l’esprit des détenus, dans une vision puissante et coup de poing. La force du groupe maintient à la verticale les individualités pour ne pas sombrer. Il y a dans cette « Maison des Morts », demeure des horizons obérés, un bel élan de vie qui apporte à l’œuvre de Janacek un souffle nouveau. Un Warlikowski de très bon cru qui mérite que l’on s’accoste aux rives Lyonnaises.
Brigitte Maroillat